Le frisson du peut-être
Où l'on cherche à explorer l'inconfort, à se connecter avec les autres et l'inattendu pour peut-être, parfois, changer sa vie.
Salut,
Cette semaine, je suis à Angers. Profitant de quelques jours sans enfant, j’ai poussé la porte de la librairie Myriagone et un sentiment familier m’a étreinte. J’ai tout de suite dit, « Oh, tiens, ça me fait penser à Fracas, à Lorient ». Je suis allée à Fracas pendant la promotion de Avortée, et c’était une expérience un peu décalante : j’étais enceinte et j’allais parler d’avortement en répondant aux questions d’un libraire. Guillaume a été un interlocuteur parfait, et j’ai été obligée d’être impressionnée par le lieu.
Parce qu’à Fracas, comme à la librairie Myriagone, les livres en stock sont sélectionnés avec un soin proche de l’exigence. Les libraires les ont, disent-ils, tous lus. On n’y trouvera pas forcément les rentrées littéraires, ni les classiques, et probablement pas les succès mainstream de la littérature populaire. Une partie de moi sourit de cet engagement, que j’envisage aussi par son prisme genré : je trouve que c’est un aplomb relativement masculin, qu’on peut percevoir comme « je vous propose ces livres, je les ai personnellement lus, et j’ai un goût impeccable ».1 Mais dans ces deux lieux a opéré en moi une magie similaire, celle que j’ai identifiée comme le frisson du peut-être.
Au risque de vous surprendre, je ne suis pas une grande flâneuse, en librairie comme ailleurs. Quand j’entre dans un magasin, en général je sais exactement ce que j’y cherche. Errer entre les rayons ne me procure pas de joie, ne me crée pas d’envie, pas de besoin, et finit parfois par m’agacer. Pour les livres, la liste de ceux que j’ai envie d’acheter est longue et occupe un coin de ma tête, j’y alloue un budget maîtrisé toujours mis en opposition à la pile de livres que je n’ai pas encore lus qui s’amoncèle dans mon salon. (Car, au risque de vous surprendre encore, j’essaye de garder cette PAL au plus bas et régulièrement, m’interdis d’acheter de nouveaux livres tant que je ne l’ai pas considérablement raccourcie.) Pour faire bref, il est rare que je me laisse tenter.
Et dans ces deux librairies aux partis pris très singuliers, j’ai ressenti une possibilité vertigineuse et excitante : peut-être qu’ici se cache un livre qui a le pouvoir de changer ma vie. C’est évidemment le cas dans toutes les librairies, même les plus classiques. Mais quelque chose dans le fait de parcourir les rayonnages muets, de ne pas comprendre comme les ouvrages sont classés, de rencontrer tant de livres absolument inconnus mais toutefois parsemés de titres familiers, réconfortants comme une balise dans un paysage sauvage, quelque chose dans le cocktail a rendu consciente, ou plutôt a rendu physique, car je l’ai ressentie dans mon corps, cette pensée puissante.
Peut-être qu’ici se cache quelque chose qui a le pouvoir de changer ma vie.
J’étais à Myriagone accompagné de deux ami·es, dont l’un me faisait part de sa réticence à fréquenter cette librairie. Tout est trop opaque pour lui, ça l’agace de ne pas savoir où donner de la tête, ça lui donne un sentiment d’élitisme, de snobisme. Il n’a pas envie de devoir demander, il dit : « Parler à des gens ? Brrr. » Et je peux le comprendre. Je pense que je suis devenue, grâce à mon métier, très à l’aise en librairie — ce sont toutes, un peu, mes deuxièmes maisons, mais je sais aussi qu’il m’a fallu beaucoup de temps pour oser demander à un·e libraire un livre que je ne trouvais pas en rayon. Pour autant mon ami, tandis que nous flânions, a été intrigué par un titre, a tiré un livre d’une étagère, en a lu quelques pages. Dont nous avons parlé ensuite pendant quelques temps, tout de même, une fois sortis de la librairie, et qu’il a rementionnées plus tard dans le bus. Quelques pages d’un livre tiré au hasard dans un lieu peu familier ont créé : une pensée. Ont généré : une conversation.
Ça n’a pas changé nos vies, mais ça a modifié perceptiblement notre après-midi. Et qui peut dire ce qui serait advenu, si mon ami avait... acheté le livre ?
Quelques jours plus tôt, j’ai dîné dans un restaurant avec d’autres amis (penser à aller dire à l’adolescente que j’étais dans les années 2000 qu’un jour, il y aurait beaucoup d’amis dans mes anecdotes). Un endroit (très bon et) très fonctionnel, où on peut commander en ligne : plus besoin d’attendre qu’un membre du personnel nous repère, vienne prendre notre commande, plus besoin de mal prononcer des plats aux noms inconnus, plus besoin... « de parler à des gens, brrr ». Et nous nous disions exactement ça : à la fois, hmm, quel confort de pouvoir obtenir exactement ce que l’on veut sans avoir à interagir avec un·e inconnu·e. À la fois, hmpf. Sommes-nous en train de disparaître, et par nous je veux dire, ce qui fait de nous ce que nous sommes, l’interaction justement, l’émotion. L’inconfort.
*
Depuis quelques jours je suis hantée par ce post d’une psychologue américaine, que j’ai vu mis en circulation pour la première fois par Eva Kirilof, et repris depuis par beaucoup. Elle dit, je vous le traduis :
Tout le monde veut un village, mais personne ne veut être un·e villageois·e. Cela veut dire que les gens veulent être soutenus par une communauté solide, mais ils n’ont pas envie de faire les efforts et les sacrifices nécessaires pour en faire part. Être agacé·e est le prix à payer pour être en connexion, en communauté. Cela peut vouloir dire partager son espace quand c’est incommode, être présent quand on préférerait rester chez soi, ou accueillir quand on est fatigué. À un moment, notre peur de l’inconfort s’est transformée en hyper-indépendance — des limites plus strictes, des routines parfaites, pas d’interruption. Mais quand nos limites deviennent trop rigides, elles cessent de nous protéger et commencent à nous isoler. Elles deviennent des murs. Et on se demande pourquoi on se sent si seul. On paye notre confort par une coupure d’avec les autres. On a échangé le désordre de la communauté pour la facilité de la solitude, et ce faisant, on a perdu quelque chose de vital.
Tout ça résonne beaucoup pour les parents, si j’en crois qui j’ai vu le repartager ensuite, puisqu’on commence par cette idée du village — il faut tout un village pour élever un enfant, bla bla. Mais si ces mots me traversent encore et encore, c’est parce que je sens profondément en moi qu’ils s’adressent à la communauté des humain·es en général. Tout le monde a envie d’être entouré, tout le monde a besoin de soutien. Mais c’est de plus en plus compliqué de se mettre dans une posture d’inconfort, que ce soit pour donner le soutien, comme pour le recevoir.
Très récemment, à plusieurs reprises j’ai essayé de soutenir des gens (de show up)2 et c’était très inconfortable, parce que ce que j’ai donné n’était pas ce qui faisait du bien. Mon premier réflexe a été de me replier sur moi-même : puisque c’est comme ça qu’on me reçoit, je vais arrêter de faire un effort. Et de nombreuses fois dans ma vie, des gens ont essayé de m’aider, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, et ça m’a été inconfortable parce qu’il m’a fallu comprendre pourquoi même quand on me tendait la main, je n’étais pas contente, satisfaite, guérie, soulagée, rayer la mention inutile. Là aussi, j’ai eu plusieurs fois envie de me retirer du monde, l’adage d’ailleurs ne dit-il pas : on n’est jamais mieux servi que par soi-même ?
Il y a quelques semaines, sur recommandation de mon amie Nine, j’ai regardé ce court documentaire appelé « Radical Neighbouring, qui donne un aperçu de la vie d’Adam Wilson, un homme à qui on a donné une ferme et ses terres et qui depuis, les cultive pour offrir à tout le monde les produits de ces terres. Quelque chose en moi a été, là aussi, profondément déplacée3, et je me suis abonnée à sa newsletter. Dans ses deux derniers envois, il y a ces deux passages qui m’ont marquée :
Une fois qu’on s’est mis d’accord sur le prix, l’argent sert éviter tout sentiment gênant d’être redevable. Ouf ! 4
Et
« Que ressens-tu quand tu t’imagines dire oui à cette requête — un sentiment d’oppression, ou d’expansion ? Remarques-tu la présence d’un tableau de score mental ? Si c’est le cas, merci d’honorer notre engagement mutuel en disant non. Souviens-toi que notre relation sera mise en danger par un oui de mauvaise grâce, mais se trouvera approfondie par un non franc et sincère. »5
C’est inconfortable de dire non, et de le recevoir. C’est tellement moins facile, aussi : ça nous arrangerait toutes et tous, de pouvoir prendre (et même donner) tous les oui en ignorant la mauvaise grâce. Mais si on élimine toutes les interactions compliquées, tous les moments d’inconfort, toutes les zones de friction ou de conflit, qu’est-ce qu’il nous reste ? Une grande solitude, comme le disait plus tôt Francesca Tighinean. Et, en fonction du pouvoir qu’on a sur le monde, un entourage de yes people, des relations inauthentiques avec des gens qui n’ont pas d’intérêt à nous dire la vérité.
Cela m’amène à la dernière newsletter d’Isabelle Sorente, où l’autrice nous raconte que cet été, elle n’a plus eu envie de mentir, plus envie de décommander en disant « Je suis un peu malade » quand la vérité était qu’elle était fatiguée, ou qu’elle n’avait tout simplement pas envie. En faisant le vœu désormais de dire la vérité, Isabelle observe ce qui se passe dans ces espaces d’inconfort :
Ce qui intéresse ma partie secrète n’est pas la culpabilité mais l’observation. Je note les situations qui me font sonner faux. Je finis par me retirer du groupe Whatsapp. Il y a d’autres situations et d’autres fausses notes que je n’arrive pas à rendre justes pour l’instant. Ce n’est pas l’abstinence qui compte, c’est le mouvement, c’est la pratique, c’est le fait d’être en route.
Dans ma pratique de la parentalité, je passe beaucoup de temps à mesurer ma propre honnêteté. Si je dis à ma fille « je n’ai pas envie de jouer aux petites voitures », plutôt que « je n’ai pas le temps de jouer avec toi », je suis plus honnête, mais je dois beaucoup plus m’assumer. Je dois lui expliquer que j’ai le droit de ne pas avoir envie, que c’est plus rigolo de jouer ensemble quand on est toutes les deux enthousiastes. Mais je dois aussi faire en sorte d’avoir, plus tard, cette envie, de lui offrir ce qu’elle me demande. Je lui suis redevable.
Tandis que si je prends l’excuse, facile et pratique, de ne pas avoir le temps, je mets fin à toute négociation et je ne m’engage à rien : je peux prétendre que le temps est une ressource finie, dont je ne suis que rarement la maîtresse.6 Sur le long terme, qu’est-ce que je préfère ? Que ma fille pense que je n’ai pas le temps pour elle, ou qu’elle apprenne que je suis une personne avec mes propres moteurs, et que nos envies/besoins ne sont pas toujours alignés naturellement, que c’est un travail, finalement, que d’être en relation ?
Si je dis « je n’ai pas le temps de jouer avec toi », je mens un peu et j’ai la paix : c’est confortable. C’est un mur. Elle peut être triste, je peux répondre : c’est comme ça. Si je dis « je n’ai pas envie de jouer aux petites voitures avec toi maintenant », j’ouvre une succession de fenêtres : pas les petites voitures mais peut-être un puzzle ? Pas maintenant mais peut-être plus tard ? Pas jouer mais peut-être faire un câlin ? Et je dois gérer ça.
Ce n’est pas le plus confortable.
C’est le plus humain, et c’est aussi celui qui contient le frisson du peut-être.
Car il arrive, vraiment plus souvent que je ne l’aurais pensé, que les négociations débouchent sur quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Je découvre, plus tard ou maintenant, qu’en fait je veux bien jouer aux petites voitures. Ou que j’aime les puzzles (s’ils font max 50 pièces). Que moi aussi, j’avais besoin d’un câlin.
*
Il y a eu une petite vague tendance, il y a quelques années, d’injonctions à « sortir de sa zone de confort ». À l’époque, j’étais une petite chose terrorisée et je me demandais pourquoi il fallait tant que ça se mettre en situation d’inconfort, de gêne, de malaise, pour vivre une vie digne d’intérêt selon des critères qui ne me parlaient pas. Aujourd’hui, je suis plus grande, plus sage, moins apeurée, et j’ai l’impression aussi qu’on glisse insidieusement vers une intolérance totale à la gêne, au malaise. Hier, j’ai vu sur Bluesky un post d’un homme qui a reçu, suite à un rencard, un texto poli pour lui dire que l’étincelle romantique n’était pas là — un texto rédigé par ChatGPT.
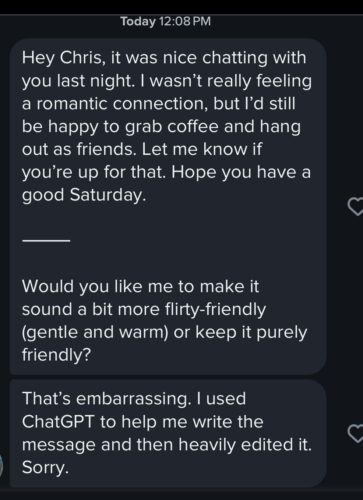
Je n’ai pas envie de vivre dans un monde où on utilise 100L d’eau pour s’éviter le ressentir l’inconfort de trouver des mots qui disent « c’était sympa mais restons amis ».
À la table ronde « Les hommes, des féministes comme les autres ? » à laquelle j’intervenais récemment au Festival des Libertés de Bruxelles7, à la fin une personne a demandé comment réagir, quand un ami nous confie qu’il est triste, mal à l’aise, de pouvoir potentiellement être perçu comme un agresseur s’il marche derrière une femme seule dans la rue. Et on était plusieurs à être d’accord pour dire : ce malaise, cette gêne, sont importantes. Elles disent quelque chose. Elles ne sont pas agréables et on préférerait ne pas les ressentir, mais à vouloir immédiatement s’en débarrasser, notamment en demandant implicitement à des amies femmes de nous rassurer, on ne fait pas le travail nécessaire à se situer dans le monde, à y porter un regard à la fois incarné et critique. L’inconfort est bavard. D’un point de vue systémique, plus on a de privilèges plus il me paraît crucial d’y rester quelques temps, pour voir ce que ça fait.
Et d’un point de vue interpersonnel, je suis convaincue que l’inconfort sert parfois de boussole vers l’authenticité. Il n’est pas toujours absolument nécessaire de sortir de sa zone de confort, mais il me paraît important d’en éprouver les limites, pour pouvoir l’ajuster, l’étendre, en sortir, bref : avoir avec elle une relation vivante.
Il existe, au-delà du familier, le frisson du peut-être, un océan de et si, qui peuvent changer nos vies.
*
Si vous avez un pouvoir d’achat qui vous le permet, j’ai envie de vous proposer une expérience. Rendez-vous bientôt dans une librairie de confiance, et demandez conseil à votre libraire. (Option no buy ou anxiété sociale : à un·e proche qui a beaucoup de livres et qui les prête.) Laissez-vous surprendre, venez avec une demande qui tient en une phrase courte. Moi, j’aime demander : recommande-moi un livre que tu as vraiment aimé. Tout simplement. Je ne demande pas à en savoir plus, ni sur le genre, sur le sujet, ou sur l’intrigue, souvent je ne demande pas pourquoi la personne l’a aimé. Il faut juste qu’elle l’ait vraiment aimé. Chacun des livres qui m’a été recommandé ainsi, à l’aveugle à part pour l’élan du cœur, m’a profondément marquée. Ce n’était pas toujours confortable, mais c’était toujours marquant.
Vous me direz ce qu’il en résulte, et vous pouvez aussi me dire quel est ce livre que vous avez vraiment aimé, vous. Moi, je vous recommanderais Piranesi, de Susanna Clarke (qui m'a été recommandé par Lucie Bryon).
Je vous dis à bientôt, prenons soin les un·es des autres.
Pauline
-
Si vous connaissez une librairie qui propose un sélection sur le même modèle du « j’ai lu / je stocke », et pas tenue par un homme : je serais ravie de le savoir et de l’ajouter à ma liste des lieux opérateurs de magie. ↩
-
Je remarque que « to show up » (littéralement se montrer, arriver) est un verbe d’action, tandis que « être présent » est un verbe d’état, plus passif. Le français aurait-il peur de bouger, de se mettre en danger ? ↩
-
Vous ne trouvez pas ça fou et beau, qu’en anglais « être ému·e » se dise « to be moved », soit littéralement, « être bougé·e » ? ↩
-
« Once the price has been settled upon, money serves to preclude any pesky indebtedness. Phew. » Becoming Counselors-in-Training, The Peasantry School Newsletter, Adam Wilson. ↩
-
“What do you feel when you imagine yourself saying yes to this request—constriction or expansion? Do you notice the presence a mental scorecard? If so, please honor our commitment to one another by saying no. Remember, our relationship will be endangered by a half-hearted yes; it will be deepened by a wholehearted no.” Resentment: Rolling the ten ton boulder, The Peasantry School Newsletter, Adam Wilson. ↩
-
Prétendre seulement, parce qu’avec les enfants comme avec nos loisirs, nos amitiés, nos temps de repos : on a souvent (pas toujours, mais souvent) plus d’agentivité sur notre temps que ce qu’on veut bien croire ou dire. ↩
-
Que vous pouvez réécouter ici. ↩
-
Eh bien merci d'avoir à ton tour recommandé Piranèse, que je viens de terminer. Je ne te cacherai pas que de ne rien en savoir m'a empêché de m'y sentir bien au tout début, mais je me suis laissée porter et au final, j'ai vraiment beaucoup aimé, je pense que je m'en souviendrai longtemps.
Voilà ma recommandation d'un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé (au point de le citer régulièrement comme mon livre préféré) : Le seigneur des porcheries, de Tristan Egolf (TW c'est très sombre). Je ne crois pas que tu l'aies lu (si j'en crois ton Goodreads et ton Storypgrah, en tout cas).
-
Pour ce qui est de la différence entre les Francais et les Anglo-Saxons pour soutenir quelqu'un, je trouve que tu as plutôt raison. Et puis pour le village aussi. Depuis que je vis en Allemagne, et dans une région rurale, je me rends compte que je n'ai aucun mal à offrir mon aide ou mon soutien, et que j'ai par contre beaucoup de mal à l'accepter ou carrément à demander (horreur! malheur!). Pourtant, vu où je vis, les gens qui me connaissent me connaissent, savent ce qu'il se passe dans ma vie et donc vont me proposer leur aide ou simplement offrir un câlin ou un encouragement alors que je n'ai rien demandé. Ca a été une adaptation. Même si j'ai passé mon enfance et mon adolescence dans un village, j'avais oublié. En plus, étant Francaise (même si je ne suis pas la seule étrangère, loin de là, on n'est quand même pas très nombreu.x.ses), je sors du lot et les gens se/me demandent quelle mouche a bien pu me piquer d'aller m'enterrer dans ce trou d'Ex-Allemagne de l'Est. Donc, des questions (très) personnelles et un peu l'obligation de répondre si je veux m'intégrer... Bon, ca fait presque 6 ans donc je suis intégrée mais à chaque nouvelle rencontre, c'est le même cirque et le même inconfort... Maintenant, j'apprécie et je trouve les Francais finalement assez froids...
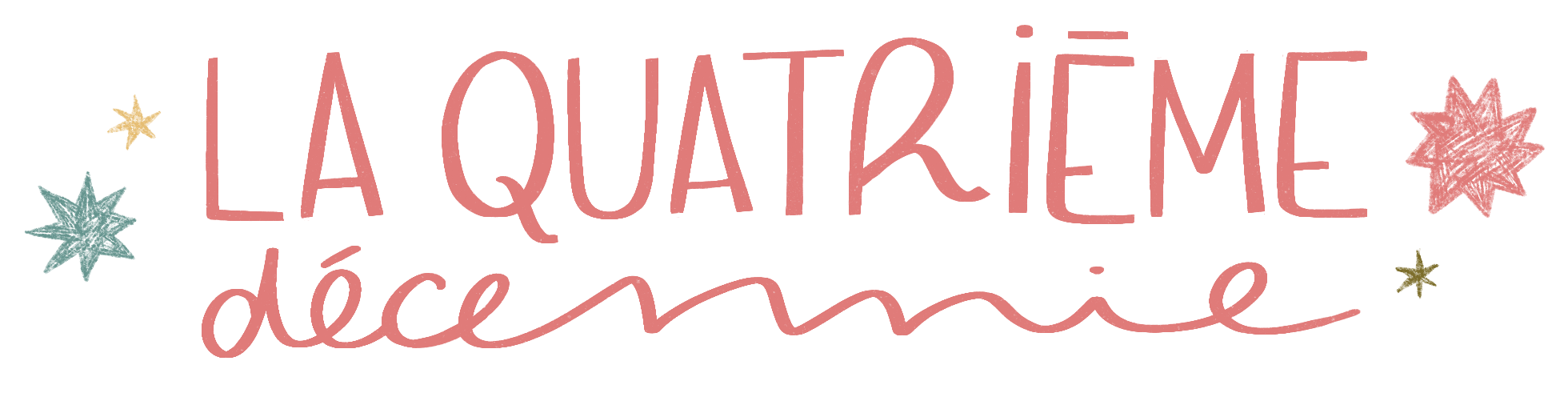
Ajouter un commentaire: